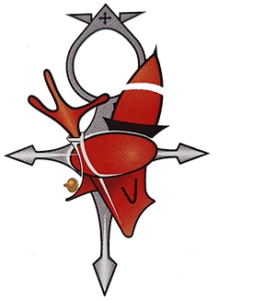Hommage à Théodore Monod
Nous rendons hommage à Théodore Monod, qui fut notre président d’honneur et un soutien précieux. Il nous a apporté beaucoup, rendant son souvenir très vivant et souvent encore d’actualité.
Comme le montrent les documents que vous pouvez visionner sur notre site, il a partagé avec ses amis habitant Sahara ou ailleurs, tant de moments de connaissances et de questionnements sur les découvertes à venir.
Vous trouverez ci dessous un documentaire mis à disposition par notre administratrice Madeleine Seemann et une somme de documents mis en ligne par notre administrateur Bernard Adell, fondateur du musée saharien http://museesaharien.fr/theodore-monod.fr

Chers amis(es) du Comité Rhône-Alpes,
Le 22 novembre 2000, Théodore MONOD nous quittait pour d’autres horizons lointains…!
La situation sanitaire actuelle ne nous permet pas de lui rendre hommage au cours d’une de nos rencontres sahariennes mensuelles, aussi je vous propose de le revoir dans une vidéo réalisée à l’occasion de l’émission Les 4 vérités en 1997.
Les 4 vérités : Théodore Monod, scientifique / vidéo 09 avril / 1997 5101 vues / 07min 12s
Le journaliste Gérard LECLERC reçoit Théodore MONOD, le naturaliste nomade coureur de désert, qui fête aujourd’hui ses 95 printemps. Il attribue cette longévité à une bonne hérédité, une vie saine et frugale accompagnée de jeûne…
Il revient sur les hasards de sa carrières qui l’ont amené au désert et obligé à s’intéresser à d’autres sciences que la zoologie. Il explique son jeûne de Taverny, en souvenir des bombes de Hiroshima et Nagasaki, date à partir de laquelle nous sommes entrés dans l’ère atomique. Peu optimiste sur l’avenir, il sait que l’homme continuera à aimer la guerre, l’argent et le profit.
Nous aurons, je l’espère, l’occasion d’évoquer sa mémoire en 2021, lorsque nous pourrons de nouveau nous réunir autour d’une conférence ou d’une projection.
En vous souhaitant de terminer cette année dans de bonnes conditions, recevez mes meilleures salutations sahariennes.
Madeleine SEEMANN
présidente du Comité Rhône-Alpes
Téléphone : 06 74 84 41 06
E-mail : madeleine.seemann@wanadoo.fr