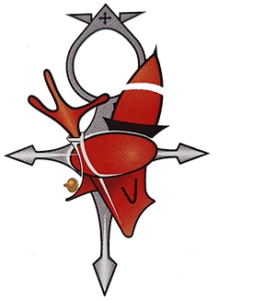© Sébastien Boulay
Sébastien Boulay est docteur en anthropologie, maître de conférences à l’université Paris Descartes. Ses champs de recherche concentrés sur tout l’Ouest saharien concernent les sociétés sahariennes, la culture matérielle, la poésie politique, le patrimoine, l’environnement, les mobilités…. S’il travaille aujourd’hui prioritairement sur les identités numériques et la circulation des messages politiques sur le web dans le Sahara, il continue à enrichir le sujet de sa thèse de doctorat, soutenue en 2003, qui était consacrée à l’évolution de la tente bédouine en Mauritanie. Il y décrivait comment cet objet qui avait perdu de son utilité en raison de la sédentarisation des populations nomades a trouvé une nouvelle place dans la société mauritanienne.
La tente est indissociable de l’image du nomade saharien. Ceux-ci se sédentarisant, est-elle amenée à totalement disparaître ?
Ce n’est pas pour tout de suite. D’abord, au sein des groupes de pasteurs nomades, la tente garde encore aujourd’hui son statut d’habitation principale de la famille. Bien sûr, dès la sédentarisation, elle est vite abandonnée au profit d’un habitat en dur, fixe. Cette étape accompagne le changement du mode de vie.
Toutefois, la plupart du temps, la tente originelle est conservée dans une pièce de la maison. Elle peut à tout moment être remontée pour constituer un abri secondaire d’agrément. En revanche, la tente connaît un renouveau manifeste chez les citadins de longue date. D’abord parce qu’elle reste le type d’abri le plus adapté au climat mauritanien. Ensuite, et surtout, parce qu’elle est investie de nouvelles valeurs et est mise au cœur de démarches identitaires.
Comment, en ville, la tente a-t-elle pu acquérir ce statut d’emblème de l’identité bédouine ?
À première vue, elle n’avait plus vraiment de raison d’être dans des villes comme Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Pourtant, surtout chez les premières générations de citadins, ceux arrivés dans les années 70 et 80, elle est très présente. Comme abri d’agrément. Elle est montée à demeure, devant la maison ou sur le toit terrasse. Profitant du confort qu’elle apporte lors des grosses chaleurs, elle est utilisée comme espace de réception en lieu et place du salon de la maison. À tel point qu’on peut y trouver une télévision…
Lors des événements importants, comme les mariages, plusieurs tentes sont dressées pour accueillir le reste de la famille et les amis. Toutefois dans ce cas, son statut change car il est question de tentes modernes, à la décoration sophistiquée. Elle devient un objet ostentatoire qui témoigne du statut social.
Enfin, elle est utilisée lors de l’hivernage, une pratique remise à la mode depuis une quinzaine d’années et encouragée par les autorités. La route principale au sud de Nouakchott est alors bordée de chaque côté de tentes blanches constituant des campements de néo-bédouins. Des familles s’y installent pour des périodes de deux semaines à trois mois. Femmes et enfants y vivent, les pères repartant travailler chaque jour en ville. La première motivation de ces familles est de retrouver la vie bédouine qu’ils ont connue dans leur enfance ou que leurs parents leur ont racontée. Le paradis perdu, le retour à la nature.
Quels enseignements sur la société maure actuelle peut-on tirer de l’observation de la place de la tente ?
Dans la société nomade, c’était un objet social total. Avec la sédentarisation, elle a été délaissée. Elle est petit à petit devenue un objet d’agrément ou de loisir, acquérant le statut d’emblème vivant d’une culture révolue et, pour les citadins les plus installés, un objet d’ostentation. Ces différents usages sont autant de reflets des multiples facettes d’une société à plusieurs vitesses, en pleine crise de valeurs. Il faut noter que la tente honorée en tant qu’accessoire emblématique du retour à la brousse par des citadins nostalgiques, n’a pas été retenue dans les programmes de valorisation du patrimoine, plus influencés par des critères occidentaux.
Mais je n’en ai aucun doute, la tente des Maures a encore de nouvelles et singulières carrières devant elle, accompagnant durablement les changements de la société.
 Les Sahariens vous convient à assister à leurs rendez-vous mensuels parisiens. Voici le programme de cette première moitié de 2015. Ces conférences sont ouvertes à tous, se tiennent au cœur de Paris dans les locaux de l’Iremmo-l’Harmattan, tous les deuxièmes mardi, à 19 heures.
Les Sahariens vous convient à assister à leurs rendez-vous mensuels parisiens. Voici le programme de cette première moitié de 2015. Ces conférences sont ouvertes à tous, se tiennent au cœur de Paris dans les locaux de l’Iremmo-l’Harmattan, tous les deuxièmes mardi, à 19 heures.